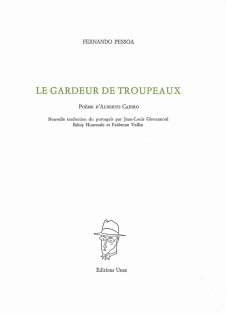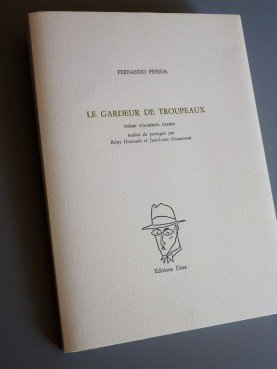Fernando Pessoa
Le gardeur de troupeaux
Les éditions Tinto da China (Lisbonne) ont fait paraitre en avril 2016, dans une édition établie par Jerónimo Pizzaro, Les œuvres complètes d’Alberto Caeiro, à partir des manuscrits de Fernando Pessoa découverts en 1979 et conservés à la Biblioteca Nacional de Portugal. Ce volume présente notamment de nombreuses variantes et corrections que Fernando Pessoa a introduites dans les cahiers dans lesquels il a recopié la toute dernière version du Gardeur de troupeaux. Jean-Louis Giovannoni et Rémy Hourcade (qui l'avaient déjà traduit 30 ans plus tôt), avec le renfort de Fabienne Vallin, ont entrepris une retraduction intégrale du texte en se basant sur cette dernière édition et les nouveautés qu’elle apporte.
Le gardeur de troupeaux est l’œuvre majeure d’Alberto Caeiro, le maître naturaliste des hétéronymes inventés par Fernando Pessoa. Berger imaginaire qui mène le troupeau de ses idées, homme sans grande éducation, ce n’est pas un intellectuel raffiné. Sa poésie est simple et directe, il est le poète des sens, du monde et de la nature, pas de la pensée. « Je n’ai jamais gardé de troupeau », commence-t-il par nous dire. Caeiro est poète, c’est sa façon à lui d’être seul, ajoute-t-il. Seul dans un monde peuplé d’hommes qui pensent comprendre le monde, qui vivent dans l’illusion de la pensée, des images, du sens caché des choses. Caeiro nous apprend la douce leçon de la simplicité, il nous dit ce que c’est que voir, aimer, lire, marcher. Voir c’est ne pas penser, c’est considérer ce que l’on a devant soi, l’immédiateté de la présence des choses. La sensation immédiate des odeurs de l’été, de la couleur des fleurs de la nature, de la chaleur du soleil. Caeiro nous apprend à regarder le monde tel qu’il est, il nous apprend à désapprendre les images et tout son poème exprime la difficulté de voir le visible. Il nous incite à accepter notre modestie, notre calme ignorance, notre petitesse paradoxale, car on est aussi à la taille de ce que l’on voit. Nous passons et disparaissons, sans trop de bruit, dans la permanence du monde, dont nous devons accepter sans tristesse qu’il n’a pas de sens ; qu’il est, tout simplement, et que nous sommes. Caeiro, en nous racontant le vent qui passe sur la colline, le bruit des arbres et des rivières, nous débarrasse de tout mysticisme, nous apprend la proximité de la réalité contre la distance, l’horizon flou des rêves.
1986, 1993, 2018 (nouvelle traduction avec des variantes inédites)
Traduit du portugais par Jean-Louis Giovannoni, Rémy Hourcade et Fabienne Vallin
64 p., 9782877041898, 17 €
Tirage de tête