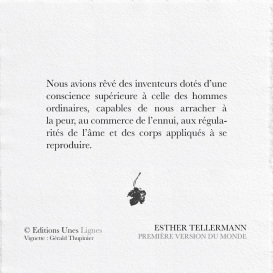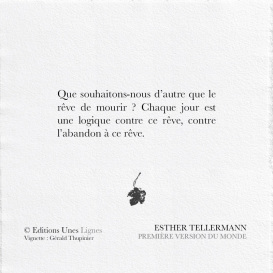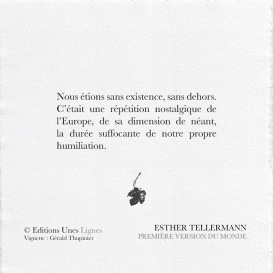Esther Tellermann
Première version du monde
Je pense que cela se terminera ainsi : sur une première image. Nous voulions remonter le fil de notre histoire mais avions renoncé à parler. C’était l’application d’une règle, d’un principe. Quelque chose attendait et il fallait le retrouver.
– Pourquoi me disais-tu que tu ne savais pas ?
– Je ne savais pas et tout à coup je sais.
– Les enfants peut-être se collent au monde.
– J’étais proche d’elle.
– On ne sait jamais de quoi est faite une proximité.
– Une tristesse peut-être…
– La mort n’est pas un accident.
Dans une fable tragique, des silhouettes coulées dans les « digressions de l’existence » mêlant leur voix, embrassent les impasses d’une humanité prisonnière des répétitions de l’Histoire. Actrices d’une paranoïa contemporaine généralisée, balancées entre le meurtre et l’oubli, le sexe et la fondation, elles traversent les drames comme en rêve, mais un rêve violent et désespéré, sans autre prise que la chair. Comment faire encore avec les vieilles images des livres ? Que reste-t-il à raconter ? Quelle dernière fiction inventer pour contrer notre désir de destruction ?
Pris dans les images, les vitrines, les bruits de mitraillette, l’homme a perdu la légende. Il est le propre jouet de sa fuite en avant, de ses tortures, de son impuissance. Il perd pied, tourne sur lui-même, dans son excès de moyens de se croire en vie. Alors il s’abandonne, toujours trop brièvement, dans le corps de l’autre, en dernière consolation. Il se souvient de l’odeur de la détresse, car au fond, « c’est soi qu’on aime, c’est soi qu’on tue ».
Esther Tellermann, dans ce livre fulgurant, demande comment infléchir cette première version du monde, hors de la répétition du même, et de notre « acharnement à disparaître ».
2018, 148 p., 9782877041935, 20 €