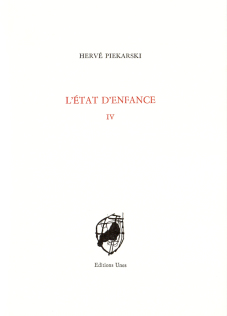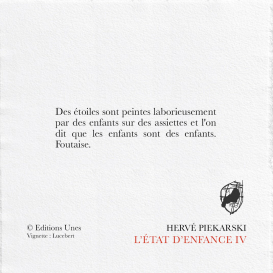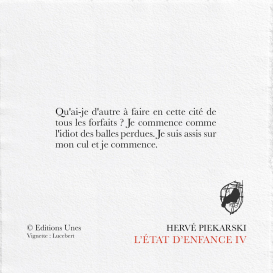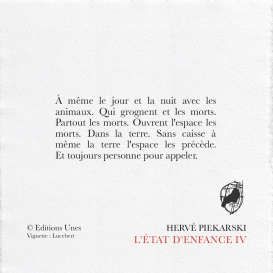L'État d'enfance IV
Mais la forme fuit. Nul carcan ne pourra la retenir dans sa fuite. Pas seulement mourir mais aussi empêcher le vent de se lever à l'intérieur. Nous sommes des paroles que nul n'aura su prononcer. Nous ne sommes plus capables de faire partie d'un peuple, nous avons oublié de signaler notre passage et maintenant que le soir tombe nos maisons nous semblent plus vides que jamais. L'espace lancé à sa propre poursuite se retourne comme un gant.
L’État d’enfance est un vaste projet littéraire initié en 1992 et dont nous publions aujourd’hui le quatrième volume. Livre d’heures composé de fragments de prose compacts arrachés à la nuit, véritable poésie-sismographe, dont l’aiguille sensible note le moindre soubresaut, la plus intime variation d’un « vent intérieur » – sautes, griffures de cette aiguille, qui sont autant de signes et de blessures. Le temps est « devenu le regard », dit Hervé Piekarski dans ce livre ouvert et infini qui est peut-être avant tout une « méditation scopique ». Chaque nuit y creuse un peu plus la nuit, chaque nuit enfonce la nuit même un peu plus loin, pour aller toucher quelle lumière ? Celle du récit peut-être, de cette grande trame qui nous recouvre comme la nuit recouvre le monde, dans laquelle Piekarski vient gratter le temps, sans jamais s’affranchir du réel. Ni des souvenirs, des maisons du souvenir, ni de la présence du bégonia dans la cour, de la radio qui crépite dans la cuisine, des pavillons de banlieue, ou de l’imaginaire du roman noir avec ses berlines sombres sur des parkings, ses coups de revolver, ses hommes en imperméable et les femmes au rouge-à-lèvres incandescent. Autant de flashes fugaces, de fulgurances de récits pris en route et remis à plus tard, pleins de lieux natals, de silhouettes et de fables. Il s’agit de dresser l’histoire de l’homme, de trouver la coïncidence totale de la langue et du récit, mouvement qui réunirait en un seul geste l’origine et la fin. Fin, ou béance, ou faillite. Ce qui menace l’homme chez Piekarski, ce qui dévore jour après jour le foie de Prométhée, ce n’est pas l’aigle (divin), mais lui-même : une « bête sourde et aveugle, issue de la chair de son foie ». Difficile d’échapper à sa propre dévoration. Il faudrait alors poser sur le papier une possibilité de langage, une barque de mots pour traverser ou remonter le temps, l’espace intérieur, le passé, les échos. Le cœur comme les étoiles est en expansion constante, c’est pourquoi il faut prolonger le geste d’écrire, de noter, face à l’accumulation sur soi du temps, de la mort, de la nuit. Barque, « abri », ou « bivouac » : écrire un lieu qui résiste. Piekarski tient dans ces pages une position de présence et de retrait simultané, il est en « observation », comme si le corps pouvait devenir l’espace réversible du temps et de la fiction, de la vie et de la mort, de la fable et du prosaïque. Il ouvre l’espace par le langage, la pente des enfers qu’il nous appartient de descendre ou de monter, chacun dans son mystère et sa nuit propre. Tenir encore le récit pour repousser un peu la faillite humaine, « la faillite mondiale du langage ». Descendre chercher la noirceur et la douleur jusqu’à la rupture avant que « la nuit ne referme son cercle », avec pour seul bagage une langue poétique qui n’est pas le langage, mais la langue du langage. On songe à Orphée, un Orphée dont l’Eurydice serait le langage et qui ne pourrait en contempler la puissance destructrice sans disparaître soi-même, mais comme le dit Piekarski dans un dernier vertige : « Orphée parce que le monde entier se retourne ».
2024, 184 p., format 15 x 21 cm, broché cousu, ISBN 978-2-87704-273-4, 25 €
Imprimé en France